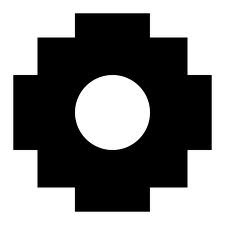Il est très, très, mais alors très compliqué d'expliquer la cosmogonie andine.
Il est très, très, mais alors très compliqué d'expliquer la cosmogonie andine.Tu veux que je te fasse un dessin?
Eh bien justement, en regardant le dessin, ami lecteur, tu risques de rester encore plus perplexe...
La Chakana andina, c'est la représentation par l'image de l'univers tel qu'il est conçu depuis des siècles, voir même des millénaires d'ailleurs, par les populations andines. La base de cette conception repose sur le principe de dualité. Dans les Andes, tout a son double: le Soleil et la Lune, le masculin et le féminin, l'eau et le feu, l'hiver et l'été, les semences et les récoltes. Rien n'est unitaire, tout est double et chaque chose a elle-même deux facettes.
La Chakana représente d'abord ça. Ensuite, j'ai vu que suivant de savants calculs on pouvait orienter le schéma selon un axe Nord Ouest-Sud Est qui correspond au Qhapaq Ñan, l'ancienne route inca. Les saisons tournent (à l'envers, hémisphère sud oblige) autour de cet axe et dans le même mouvement le calendrier agricole et rituel. Ce rythme là n'a rien d'exceptionnel. Dans toute l'Amérique indigène c'est le même ou quasiment, toujours basé sur le mouvement des astres et sur la répétition des saisons. On se dit alors, en y réfléchissant bien, quoique pas trop en fait, que notre calendrier est lui complètement en décalage avec la nature et le cosmos. Les mois ne sont pas lunaires, les saisons à peine évoquées. On ne se demande alors plus vraiment pourquoi nos sociétés sont aussi stressées... En fait, nous sommes dans le monde "moderne" (la bonne blague) en perpétuel effet de décalage horaire.
La Chakana andina, c'est la représentation par l'image de l'univers tel qu'il est conçu depuis des siècles, voir même des millénaires d'ailleurs, par les populations andines. La base de cette conception repose sur le principe de dualité. Dans les Andes, tout a son double: le Soleil et la Lune, le masculin et le féminin, l'eau et le feu, l'hiver et l'été, les semences et les récoltes. Rien n'est unitaire, tout est double et chaque chose a elle-même deux facettes.
La Chakana représente d'abord ça. Ensuite, j'ai vu que suivant de savants calculs on pouvait orienter le schéma selon un axe Nord Ouest-Sud Est qui correspond au Qhapaq Ñan, l'ancienne route inca. Les saisons tournent (à l'envers, hémisphère sud oblige) autour de cet axe et dans le même mouvement le calendrier agricole et rituel. Ce rythme là n'a rien d'exceptionnel. Dans toute l'Amérique indigène c'est le même ou quasiment, toujours basé sur le mouvement des astres et sur la répétition des saisons. On se dit alors, en y réfléchissant bien, quoique pas trop en fait, que notre calendrier est lui complètement en décalage avec la nature et le cosmos. Les mois ne sont pas lunaires, les saisons à peine évoquées. On ne se demande alors plus vraiment pourquoi nos sociétés sont aussi stressées... En fait, nous sommes dans le monde "moderne" (la bonne blague) en perpétuel effet de décalage horaire.
Mais revenons en à la Chakana. Voyant ce système de représentation cosmogonique profondément logique bien enraciné dans les Andes, les missionnaires catholiques, à l'époque de la Conquête et de la Colonisation des empires américains, se disent, dans ce qui leur reste de lucidité, qu'ils ne pourront pas faire autrement que de reprendre cette organisation de l'univers dans leurs discours d'évangélisation. Effectivement, c'était loin d'être idiot. C'était d'ailleurs déjà la méthode des Incas qui, en intégrant les ethnies conquises au territoire du Tawantinsuyu, en avaient aussi absorbé les croyances, incapables de lutter contre le pouvoir des huacas locales et dans l'impossibilité d'imposer le Dieu Soleil, Tata Inti, comme dieu unique. Bref, les missionnaires catholiques étudient avec précisions la cosmogonie des indigènes ainsi que leurs divinités et voici ce qu'il en ressort:
- on calque les fêtes du calendrier catholiques sur les célébrations rituelles du calendrier andin. Noël tombe ainsi très bien au moment du solstice d'été, le Corpus Christi au moment du 24 juin ou fête du Soleil, Inti Raymi, notamment chez les Incas, et ainsi de suite.
- les saints du calendrier caholique ne sont pas en reste et, même si ça fait un peu "païen", on leur attribue les pouvoirs des divinités locales. Exemple très fréquemment cité, le 24 juillet, Santiago, Saint Jacques, devient Illapa, le dieu du tonnerre et de la foudre, Tata Bombori dans les Andes boliviennes, je vous en ai déjà parlé.
- la Mère Terre, Pachamama, devient une mère "humaine" en la personne de la Vierge Marie.
- Jésus lui -même ressemble fort à Tunupa dont la légende court dans toutes les Andes...
Que de coïncidences dites moi, c'est fou!, se disent les missionnaires.
Seulement les indigènes, eux, ne sont pas vraiment du même avis. Attention, officiellement, si, bien sûr, ils se convertissent au catholicisme. En même temps, c'est vrai, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est ça ou finir la tête coupée, aïe. Officieusement, c'est une tout autre histoire. Il y a plusieurs théories sur le sujet. La première consiste à dire que c'est un métissage parfait, que ces deux cultures étaient faites pour s'entendre et se fusionner. C'est la version catholique. La seconde avance la théorie du syncrétisme, d'une association entre les deux religions qui aurait formé une culture multiple mais parfaitement cohérente. C'est la thèse de certains universitaires, attention, c'est un bon gros résumé. La troisième, c'est la vision éclairée de mon ami Georges Pratlong, grand spécialiste des Andes, qui hésite un peu sur ce terme de syncrétisme en tant que métissage et préfère parler de vernis catholique qui aurait recouvert les traditions andines. Il suffirait de gratter, rien qu'un peu, pour que toute la culture ancestrale ressurgisse, pas du tout diminuée ni mélangée, encore assez ressemblante avec ce qu'elle a pu être il y a des siècles. Il y a dans cette théorie là quelque chose de très important, c'est la place prise par les indigènes eux mêmes, certes dominés par les catholiques, mais acteurs, conscients ou inconscients, de la conservation mentale, rituelle, ancrée et pourquoi pas physique (quand on sait à quel point il est difficile de changer de rythme de vie, imaginons nous si ce rythme est inné à notre peuple, à notre ethnie, depuis des millénaires) de leur cosmogonie.
Seulement les indigènes, eux, ne sont pas vraiment du même avis. Attention, officiellement, si, bien sûr, ils se convertissent au catholicisme. En même temps, c'est vrai, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est ça ou finir la tête coupée, aïe. Officieusement, c'est une tout autre histoire. Il y a plusieurs théories sur le sujet. La première consiste à dire que c'est un métissage parfait, que ces deux cultures étaient faites pour s'entendre et se fusionner. C'est la version catholique. La seconde avance la théorie du syncrétisme, d'une association entre les deux religions qui aurait formé une culture multiple mais parfaitement cohérente. C'est la thèse de certains universitaires, attention, c'est un bon gros résumé. La troisième, c'est la vision éclairée de mon ami Georges Pratlong, grand spécialiste des Andes, qui hésite un peu sur ce terme de syncrétisme en tant que métissage et préfère parler de vernis catholique qui aurait recouvert les traditions andines. Il suffirait de gratter, rien qu'un peu, pour que toute la culture ancestrale ressurgisse, pas du tout diminuée ni mélangée, encore assez ressemblante avec ce qu'elle a pu être il y a des siècles. Il y a dans cette théorie là quelque chose de très important, c'est la place prise par les indigènes eux mêmes, certes dominés par les catholiques, mais acteurs, conscients ou inconscients, de la conservation mentale, rituelle, ancrée et pourquoi pas physique (quand on sait à quel point il est difficile de changer de rythme de vie, imaginons nous si ce rythme est inné à notre peuple, à notre ethnie, depuis des millénaires) de leur cosmogonie.
Alors voilà, lecteur ami. Si tu es encore plus embrouillé après lecture qu'avant, c'est que tu commences à revoir et/ou à questionner tes schémas cosmogoniques. C'est que tu prends petit à petit conscience que dans notre univers tout est lié, chaque chose dépend d'une autre, y est associée et cette association est elle même reliée au reste du cosmos. Une construction façon Tour Eiffel en allumettes: si l'une d'elles tombe, tout s'effondre. Et le monde, comment va-t-il? Bieeeenn, cher lecteur, tu progresses, bravo...
Demain je te parlerai de la Chakana en version relief, mais, comme on dit dans les Andes, demain, c'est peut-être jamais...